Les remparts de Saint-Valery-sur-Somme
- Adrien Huguet
- 14 oct. 2025
- 2 min de lecture

Saint-Valery-sur-Somme
aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
Aspect, transformation et mœurs
Adrien Huguet
15 x 21 cm - 204 pages
Le 6 juin 1586, Philippe du Bos, sieur de Drancourt, conseiller du roi et trésorier général de France en Picardie, vint à Saint-Valery pour examiner en connaissance de cause de requête présentée par les maïeurs et échevins, manants et habitants, pour la remise de leurs impositions, et il voulu bien procéder à la visite des murailles de la ville qui étaient dans un grand état de délabrement. Il s’en fut donc faire le tour des fortifications avec maître Thomas de Camyes, qu’il prit pour greffier, et deux maîtres maçons du village d’Arrest, les nommés Raoul de Quennehen et Nicolas Le Tueur, choisis comme experts, et qui prêtèrent serment de faire « bon et fidèle rapport de visitation ».
Nous ne saurions trouver une meilleure occasion pour faire connaissance avec les remparts de Saint-Valery, que de suivre Philippe du Bos et ses trois acolytes, dans leur promenade autour de la ville. Chemin faisant, nous essayerons de décrire les ouvrages devant lesquels les visiteurs des murailles passèrent ou s’arrêtèrent pour exécuter leurs toisés, et, en certains endroits, nous recueillerons de leur bouche même de précieux renseignements sur l’état des fortifications à l’époque où commence ce récit.
La ville de Saint-Valery se trouve bâtie sur une éminence située sur le bord de la mer. Au nord, un escarpement naturel, variant suivant les endroits de quarante à soixante pieds (1 pied = 33 cm), la mettait, de ce côté, à l’abri des surprises. Un revêtement de pierres soutenait la poussée des terres de cette falaise, depuis la tour de l’Echevinage, dite aujourd’hui tour Gonzague, qui est auprès de la porte de Bas, jusqu’à une autre tour dite d’Harold, qui est au pied de la porte de Haut. Du côté des champs, la ligne des fortifications formait à la ville une ceinture assez irrégulière ayant un escarpement beaucoup moins considérable.
L’enceinte avait environ six cents toises de développement (1 toise = 1,95 m).
La muraille avait une épaisseur moyenne du côté des champs, de six pieds à la base et de quatre pieds au sommet. Elle était construite en certains endroits en pierres de Boulogne et dans d’autres en pierres bises et galets taillés par moitié disposés en damier.
Le trésorier général sortit par la porte de Bas, dite aussi de Saint-Martin, d’Abbeville, ou de la Ferté, et connue aujourd’hui sous le nom de Nevers, pour se rendre sur les grèves, au-dessous de la grande muraille de l’église.


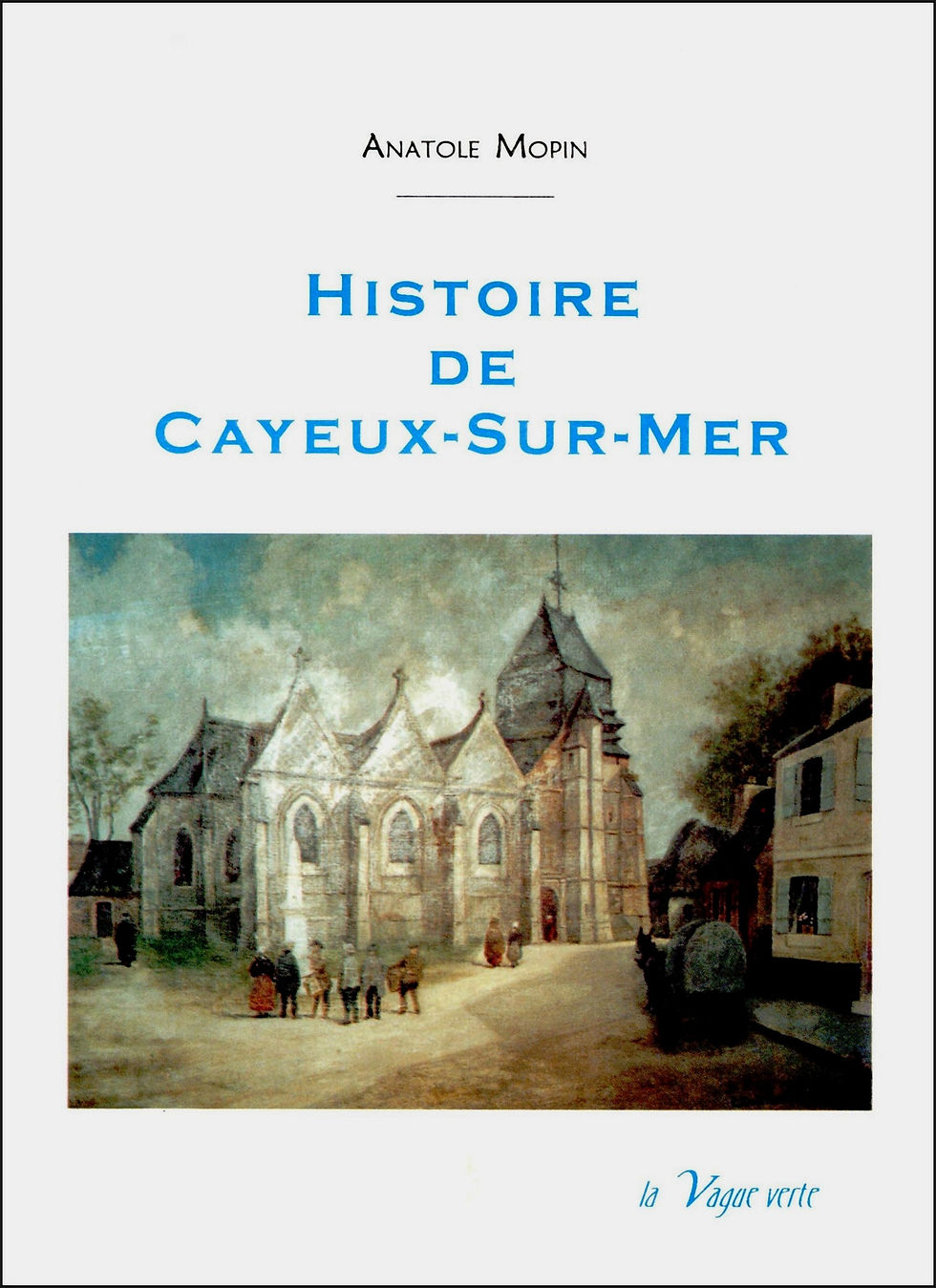
Commentaires